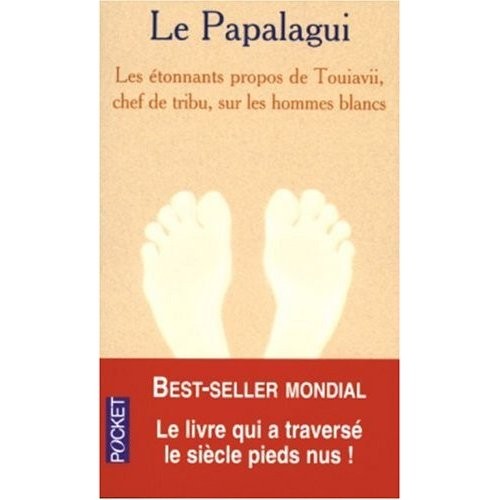
Je viens de commencer la lecture d’un petit livre étonnant : Le Papalagui. Les propos de Touiavii, chef de tribu, sur les hommes blancs, d’Erich Scheurmann.
littéralement : le pourfendeur du ciel.
Le premier missionnaire blanc qui débarqua
à Samoa, arriva sur un voilier.
Les indigènes prirent de loin les voiles blanches
pour un trou dans le ciel,
à travers lequel le Blanc venait à eux.
Il traversait le ciel.
Paru en Allemagne en 1920, traduit en quinze langues et vendu à des millions d’exemplaires, Le Papalagui avait attendu le début des années 80 pour être accessible aux lecteurs francophones dans une traduction (Aubier Flammarion) largement diffusée mais rapidement épuisée.
Le texte est présenté comme un recueil d’observations et de réflexions où la civilisation occidentale est passée au crible du bon sens d’un dignitaire samoan du début du siècle : au retour d’un voyage en Europe, Touiavii ne cache ni sa surprise ni son indignation après avoir constaté l’étrange manière dont vivent les ressortissants d’une grande puissance coloniale ; il s’amuse du manque de savoir-vivre des Blancs et s’indigne de leur hypocrisie.
Près d’un siècle plus tard, la charge n’a rien perdu de sa pertinence. L’introduction d’Eric Scheurmann souligne la portée universelle du regard de celui qu’il présente comme son ami : « Touiavii, l’insulaire sans culture, considérait toutes les acquisitions culturelles européennes comme de la folie, comme une impasse […]. Mais il le fait avec le ton de la mélancolie, témoignant que son ardeur missionnaire prend sa source dans l’amour humain, non dans la haine » (p. 13).
On sait aujourd’hui (cf. Tahiti Pacifique Magazine, n° 121, mai 2001, p. 43) que Le Papalagui est l’œuvre d’Eric Scheurmann à qui l’on doit par ailleurs un remarquable ensemble de photographies des Samoa au début du dernier siècle ; cet Allemand était suffisamment imprégné de la civilisation polynésienne pour crédibiliser une fable qui trouve son premier ressort dans l’horreur suscitée par le déclenchement de la première guerre mondiale. L’intérêt du recueil n’est pas amoindri par cette révélation. On notera que la démarche de Scheurmann s’inscrit dans une tradition inaugurée par Diderot avec son « Supplément au voyage de Bougainville » où l’on voit un des chefs de l’île haranguer les malheureux Tahitiens.
Il reste aux lecteurs curieux de littérature samoane à se tourner vers les écrits plus récents d’Albert Wendt ou de Sia Figiel. (Source de l’article : Jac Bayle)
 EXTRAITS
EXTRAITS
[…] le Papalagui pense tant que penser lui est devenu une habitude, une nécessité et même une obligation. Il faut qu’il pense sans s’arrêter. Il parvient difficilement à ne pas penser, en laissant vivre son corps. Il ne vit souvent qu’avec la tête, pendant que tous ses sens reposent dans un sommeil profond, bien qu’il marche, parle, mange et rie.
Les pensées, qui sont les fruits du penser, le retiennent prisonnier. Il a une sorte d’ivresse de ses propres pensées. Quand le soleil brille, il pense aussitôt : « Qu’il fait beau maintenant ! » C’est faux. Fondamentalement faux. Fou. Parce qu’il vaut mieux ne pas penser du tout quand le soleil brille.
Un Samoan intelligent étend ses membres sous la chaude lumière et ne pense à rien. Il ne prend pas seulement le soleil avec la tête, mais aussi avec les mains, les pieds, les cuisses, le ventre et tous les membres. Il laisse sa peau et ses membres penser pour lui. Et ils pensent certainement aussi, même si c’est d’une autre façon que la tête. Mais pour le Papalagui l’habitude de penser est souvent sur le chemin comme un gros bloc de lave dont il ne peut se débarasser. Il pense à des choses gaies, mais n’en rit pas, à des choses tristes, mais n’en pleure pas. Il a faim, mais ne prend pas de taro ni de palousami. C’est un homme dont les sens vivent en conflit avec l’esprit, un homme divisé en deux parties.
Parle à un Européen du Dieu de l’amour, il fait la moue et sourit. Il sourit de la naïveté de ta pensée. Mais tends-lui un morceau de métal rond et brillant ou un grand papier pesant, aussitôt ses yeux s’éclairent et beaucoup de salive se pose sur ses lèvres. L’argent est son amour, l’argent est son idole. Tous les Blancs y pensent, même quand ils dorment.
Mais aux pays des Blancs, il n’est pas possible de vivre sans argent du lever au coucher du soleil, même pas une seule fois. Sans argent du tout, tu ne pourrais pas apaiser ta faim ni ta soif, tu ne trouverais pas de natte pour la nuit. On te mettrait au fadé poui poui (prison) et on clamerait ton nom dans les nombreux papiers (journaux) parce que tu n’aurais pas d’argent. Tu dois payer, ça veut dire donner de l’argent, pour le sol où tu te promènes, pour l’emplacement où se trouve ta hutte, pour ta natte de nuit, pour la lumière qui éclaire ta hutte. Et pour avoir le droit d’abattre un pigeon ou de plonger ton corps dans le fleuve. Si tu veux te rendre là où les hommes ont du plaisir, où ils chantent et dansent, ou si tu veux demander un conseil à ton frère, il faut que tu remettes beaucoup de métal rond et de papier lourd… Et il te faut même payer pour naître et pour mourir, pour donner ton corps à la terre et pour la grande pierre que l’on roule sur ta tombe en mémoire de toi.
Je n’ai trouvé qu’une chose pour laquelle en Europe, on ne prélève pas encore d’argent, une chose que chacun peut commander comme il veut : l’aspiration de l’air. Pourtant, je croirais presque que ce n’est qu’un oubli, et je ne suis pas loin d’affirmer que si on pouvait entendre mes paroles en Europe, on prélèverait aussitôt le métal rond et le papier lourd aussi pour cette action-là. Parce que tous les Européens cherchent toujours de nouvelles raisons de réclamer de l’argent. Sans argent en Europe, tu es un homme sans tête, un homme sans membres. Tu n’es rien.
« C’est une chose embrouillée que je n’ai jamais vraiment complètement comprise, parce que cela m’ennuie de réfléchir plus longtemps que nécessaire à ces choses aussi puériles. Mais c’est une connaissance très importante pour le Papalagui. Les hommes, les femmes et même les enfants qui tiennent à peine sur les jambes, portent dans le pagne une petite machine plate et ronde sur laquelle ils peuvent lire le temps. Soit elle est attachée à une grosse chaîne métallique et pend autour du cou, soit elle est serrée autour du poignet avec une bande de cuir. Cette lecture du temps n’est pas facile. On y exerce les enfants en leur tenant la machine près de l’oreille pour leur faire plaisir.
Ces machines, que l’on porte facilement sur le plat de deux doigts, ressemblent dans leur ventre aux machines qui sont dans les ventre des bateaux, que vous connaissez tous. Mais il y a aussi de grandes et lourdes machines à temps à l’intérieur des huttes, ou sur les plus hautes façades pour qu’on puisse les voir de loin. Et quand une tranche de temps est passée, de petits doigts le montrent sur la face externe de la machine et en même temps elle se met à crier, un esprit cogne contre le fer dans son coeur. Oui, un puissant grondement s’élève dans une ville européenne quand une tranche de temps s’est écoulée.
Quand ce bruit du temps retentit, le Papalagui se plaint: Oh! là! là! encore une heure de passée!” Et il fait le plus souvent une triste figure, comme un homme portant un lourd chagrin, alors qu’aussitôt une heure toute fraîche s’approche. Je n’ai jamais compris cela, si ce n’est en supposant qu’il s’agit d’une grave maladie. Le Papalagui se plaint de cette façon: ”Le temps me manque!… Le temps galope comme un cheval!… Laissez-moi encore un peu de temps!…”
(…)
En Europe, il n’y a que peu de gens qui ont véritablement le temps. Peut-être pas du tout. C’est pourquoi ils courent presque tous, traversant la vie comme une flèche. Presque tous regardent le sol en marchant et balancent haut les bras pour avancer le plus vite possible. Quand on les arrête, ils s’écrient de mauvaise humeur: ”Pourquoi faut-il que tu me déranges? Je n’ai pas le temps, et toi, regarde comme tu perds le tien!” Ils se comportent comme si celui qui va vite était plus digne et plus brave que celui qui va lentement.
Le Papalagui oriente toue son énergie et toutes ses pensées vers cette question: comment rendre le temps le plus dense possible? Il utilise l’eau, le feu, l’orage et les éclairs du ciel pour retenir le temps. Il met des roues de fer sous ses pieds et donne des ailes à ses paroles, pour avoir plus de temps. Et dans quel but tous ces grands efforts?
Que fait le Papalagui avec son temps? Je n’ai jamais découvert la vérité, bien qu’il parle sans cesse et gesticule comme si le Grand-Esprit l’avait invité à un fono. Je crois que le temps lui échappe comme un serpent dans une main mouillée, justement parce qu’il le retient trop. Il ne le laisse pas venir à lui. Il le poursuit toujours, les mains tendues, sans lui accorder jamais la détente nécessaire pour s’étendre au soleil. Le temps doit toujours être très près, en traint de parler ou de lui chanter un air. Mais le temps est calme et paisible, il aime le repos et il aime s’étendre de tout son long sur la natte. Le Papalagui n’a pas reconnu le temps, il ne le comprend pas et c’est pour cela qu’il le maltraite avec ses coutumes de barbare.
Mes chers frères, nous ne nous sommes jamais plaints du temps, nous l’avons aimé comme il venait, nous n’avons jamais couru après lui, nous n’avons jamais voulu le trancher ni l’épaissir. Jamais il ne devint pour nous une charge ni une contrainte.
Que s’avance celui d’entre nous qui n’a pas le temps! Chacun de nous a le temps en abondance, et en est content; nous n’avons pas besoin de plus de temps que nous en avons, et nous en avons assez. Nous savons que nous parvenons toujours assez tôt à notre destination, et que le Grand-Esprit nous appelle quand il veut, même si nous ne connaissons pas le nombre de nos lunes.
Nous devons libérer de sa folie ce pauvre Papalagui perdu, nous devons l’aider à retrouver son temps. Il faut mettre en pièces pour lui sa petite machine à temps ronde, et lui annoncer que du lever au coucher du soleil, il y a plus de temps que l’homme en aura jamais besoin. »
anti

Quelle trouvaille que ce petit livre incroyable !
Je n’en ai lu que quelques extraits pour le moment mais dès qu’Anti l’aura fini, je saute dessus !!!
J’ai fini de lire le Papalagui la semaine dernière, vraiment, c’est un livre à lire, un de ceux qui font du bien. Deux chapitres m’ont particulièrement captivée :
– Le Papalagui n’a pas le temps
et
– La profession du Papalagui
Tous les autres chapitres sont croustillants à souhait malgré tout. Celui sur l’école, la connaissance est aussi… Mmmm… Les réflexions de Touiavii méritent toutes notre attention. On y apprend aussi que dans sa langue il n’existe qu’un seul mot « Laou » pour dire « mien » et « tien ».
Un petit livre à lire absolument pour relativiser bien des choses et envisager une petite retraite sympathique à Tiavéa Un éloge à la joie de vivre !
Un éloge à la joie de vivre !
anti
Hola a todos !
J’ai lu ce petit livre il y a déjà quelques années et je repense à lui de temps à autres. Rigolo et joli; c’est un regard exotique , intrigué et lucide sur notre mode de vie…et bien plus encore…
Très beau et à lire partout !
A bientôt !
Adi